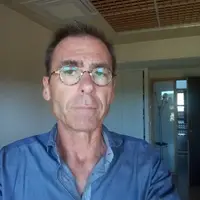
« Dire les choses, même si c’est pour dans cent ans »
Yvon Iziquel, chef de projet transition écologique à Sète Agglopôle Méditerranée, anticipe sur le recul du trait de côte. Avec ses équipes, il pilote le seul Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) dédié au recul du trait de côte en Méditerranée. Un chantier inédit, qui combine prospective territoriale, urbanisme de repli et dialogue sensible avec les habitants, acteurs économiques et les gestionnaires d’infrastructures. « Trois questions à… », la rubrique où le tutoiement est de rigueur.
Yvon, quelles évolutions anticipes-tu pour la côte sétoise d’ici à 100 ans ?
Il faut regarder la réalité en face : la côte va reculer. Dans cent ans, les deux lidos, de Marseillan et de Frontignan, auront disparu sous les eaux. La mer atteindra la frange nord des étangs. Les routes, les voies ferrées, les campings, l’habitat en bord de mer seront noyés. Tout ce qui repose aujourd’hui sur la présence de la mer – tourisme, conchyliculture, hôtellerie de plein air – devra se réinventer. À Frontignan, par exemple, 3.000 logements sont concernés. C’est un véritable casse-tête. Mais il ne s’agit pas de créer la panique. Ce qu’on fait aujourd’hui, c’est anticiper. Nous produisons des cartes de recul à 30 ans et 100 ans, et partageons ces données. Il faut que chacun commence son propre processus d’acceptation. Ce n’est pas parce que ça arrivera dans longtemps qu’il ne faut pas le dire. On doit rendre l’information accessible et compréhensible, pour que les habitants et les acteurs économiques puissent se projeter.
Le PPA est lancé sur trois ans, entre 2024 et 2026. Un groupement nous accompagne, dont Urban’Act, l’aménageur urbaniste. Une première phase a été centrée sur la connaissance du phénomène – les cartes à 30 ans et 100 ans sont presque terminées -, une deuxième sur la concertation citoyenne à travers des réunions publiques et ateliers, et une troisième sur les solutions et la réflexion prospective. De grandes orientations sont posées, et seront testées fin mai auprès des habitants.
Comment accompagner les propriétaires et les acteurs concernés ? Dans ce contexte anxiogène, comment un acteur public peut-il donner de l’espoir, construire un avenir ?
Il faut insister sur l’anticipation, pour se mettre à l’abri du risque. Cela suppose de composer avec le tissu urbain existant, de s’inscrire dans la logique du Zéro Artificialisation Nette. Nous pouvons recréer un urbanisme plus sûr, plus sobre, sans artificialiser davantage. Il faut que ce soit un projet de territoire, pas une série de mesures subies.
Parmi les pistes, la densification future de lotissements et de zones d’activités économiques, la reprise de bâtiments industriels inoccupés, la reconversion de friches. Le territoire dénombre 200 hectares de friches : ce sont autant d’opportunités de développement économique pour demain.
On ne peut pas simplement dire « votre terrain va disparaître » et tourner les talons. C’est un sujet humainement et socialement sensible. Certains refusent d’y croire, sur fond de climatoscepticisme. D’autres sont très attachés à leur maison ou à leur activité. Nous sommes là pour ouvrir le dialogue, proposer des pistes, outiller la réflexion.
Le cadre fixé par la Loi Climat et Résilience nous y aide, avec des dispositifs d’accompagnement, même si le fonds d’indemnisation n’a pas encore été abondé dans le cadre du budget 2025.
Il faut aussi que les grands opérateurs, comme la SNCF ou les services de l’État, les exploitants de réseaux secs et humides, prennent leurs responsabilités en matière d’adaptation des infrastructures. Quid, par exemple, de la ligne ferroviaire actuelle, à long terme ? Sur ces sujets, nous ne ferons pas le travail à leur place.
Selon toi, pourquoi Sète Agglopôle est-elle la seule collectivité méditerranéenne à s’engager aussi frontalement ?
Nous avons fait un choix politique : regarder les choses en face. D’autres territoires, comme Palavas-les-Flots, n’ont pas encore franchi ce cap. Son maire (Christian Jeanjean, ndlr) est tout à fait conscient du problème, mais redoute les réactions de leurs administrés. Il est vrai que chez nous, nous avons des marges de manœuvre, avec du foncier disponible et des possibilités de densification.